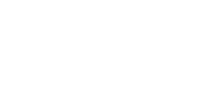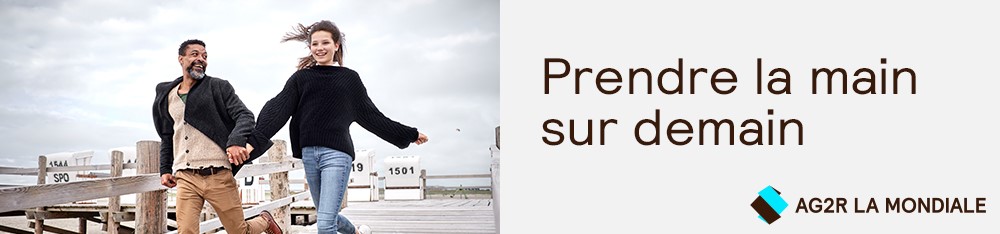L’historien et enseignant évoque également les nouveaux défis à relever pour les organisations syndicales.
Quel regard portez-vous sur la crise des gilets jaunes ?
C’est un phénomène unique dans l’histoire sociale française. C’est le premier mouvement social qui, depuis l’existence légale des organisations syndicales, leur échappe. Les gilets jaunes ont réussi, non sans poser plusieurs problèmes, à construire un mouvement et à l’inscrire dans le temps. Sans organisation nationale structurée mais avec une utilisation très efficace des réseaux sociaux, les manifestants ont mis en place de nombreuses micro-organisations locales. Enfin, ce mouvement a fait bouger les lignes, bousculant le pouvoir politique. Davantage que tous les mouvements sociaux traditionnels depuis 1995, exception faite, en 2006, de celui spécifique contre le contrat première embauche (CPE). De mon point de vue, il est probable que ce type de mouvement non structuré aura des répliques.
Pourquoi ce mouvement a-t-il échappé aux syndicats ?
Outre le fait que les revendications exprimées en matière de pouvoir d’achat, de fiscalité et de justice sociale sont traditionnellement adressées à l’État qu’on interpelle, il y a avant tout une raison sociologique. Ce n’est pas un mouvement social classique partant des entreprises sous l’impulsion des salariés et de leurs représentants. La majorité des manifestants, ouvriers, employés et professions intermédiaires, est issue de très petites entreprises. Ils sont éloignés des syndicats et du dialogue social en vigueur dans de plus grandes entreprises.
Que pensez-vous du grand débat national ?
Cette solution était incontournable. Le gouvernement, qui a fortement tendance à vouloir marginaliser les corps intermédiaires et les contre-pouvoirs, n’avait pas le choix, sauf à décider d’emblée de revoir de fond en comble la politique qui avait été menée depuis le début du quinquennat. Cela pose beaucoup de questions, notamment celle de l’omniprésence, sans réelle contradiction, de la parole présidentielle dans le cadre de ce grand débat. Le risque, à la sortie, c’est l’entrechoc entre le diagnostic réalisé par l’exécutif - largement composé d’experts et d’hommes de cabinets - et la parole laissée aux citoyens, qui suscite de fortes attentes. Il faut apporter des réponses aux revendications sur les problématiques de justice fiscale et de répartition du produit des richesses.
Quid de la question cruciale des salaires ?
Les études le montrent : par rapport à des pays de niveau comparable, les salaires en France ne sont pas particulièrement élevés. Aussi bien dans le privé que dans le public, à l’image de la rémunération des enseignants bien inférieure à la moyenne de l’OCDE. Pour éteindre l’incendie, beaucoup d’entreprises ont semble-t-il jouer le jeu en versant la prime Macron aux salariés. Ce d’autant que monte, dans l’opinion publique, une exaspération légitime face à l’évasion fiscale et aux versements toujours plus conséquents des dividendes aux actionnaires.
La future réforme des retraites voulue par le gouvernement, qui fait actuellement l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux, peut-elle être explosive ?
Oui et non. Oui car, quand on regarde les grands mouvements sociaux des dernières années, les deux plus grands l’ont été sur ce sujet ultrasensible, en 2003 et en 2010. Et non car c’est une réforme très technique et diluée pour donner le moins de prise possible aux contestations.
C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles les ordonnances Travail, en 2017, n’ont pas eu le degré de mobilisation escompté car les enjeux étaient globalement peu compréhensibles pour les citoyens. Il était compliqué, pour les organisations syndicales, d’alerter les salariés sur les risques potentiels. Et donc de créer les conditions d’une large mobilisation.
Dans quelle mesure cette crise sociale challenge-t-elle les organisations syndicales ?
Ce n’est pas la première fois que les syndicats sont confrontés à de nouvelles formes de mobilisation. Par exemple, le succès en 2016 de la pétition lancée par Caroline de Haas contre la loi El Khomri avait accéléré le calendrier de la mobilisation syndicale. Plus largement, le syndicalisme, qui n’échappe pas aux divisions, est confronté à plusieurs défis, tant au niveau national interprofessionnel que dans les entreprises. En premier lieu celui du renouvellement générationnel des adhérents. Le challenge est d’autant plus difficile que les syndicats, à l’instar des partis politiques et des médias, doivent composer avec un rejet prononcé des institutions dans l’opinion publique.
Comment appréhendez-vous le taux de syndicalisme en France (environ 11 %) ?
Ce chiffre est à nuancer. N’oublions pas que nous avons connu, pendant plus de 30 ans jusqu’à la fin des années 70, un taux de syndicalisation oscillant entre 20 et 25 %. Le modèle français a par ailleurs ses spécificités et ne peut pas être comparé, par exemple, au syndicalisme des pays scandinaves où il est indispensable d’adhérer pour disposer de certains avantages sociaux. Or il faut bien rappeler qu’environ 95 % des salariés français - syndiqués ou non - sont couverts par des conventions collectives, lesquelles sont négociées par les syndicats dans les branches professionnelles.
Que vous inspire le syndicalisme dit de service, régulièrement mis en avant ?
Il y a nécessité de se saisir de cette question. Les salariés sont très demandeurs de services et de conseils juridiques, en lien avec la montée de l’individualisation et avec la judiciarisation croissante des relations sociales et des conflits. Le contenu même des accords collectifs fait de plus en plus entrer en jeu la variable individuelle. C’est dans cette mise en oeuvre individuelle de la négociation collective que peut intervenir le syndicalisme de service, pour accompagner le salarié. Sans en faire un syndicalisme clientéliste, les syndicats restant avant tout un instrument de la négociation collective.
Depuis le début du quinquennat, l’exécutif a tendance à malmener les corps intermédiaires…
Cette tendance est loin d’être inédite. Vilipender et vouloir contourner les corps intermédiaires est un axe structurant de la pensée politique française depuis plus de deux siècles. Emmanuel Macron s’inscrit dans cette tradition du pouvoir souhaitant s’adresser directement aux citoyens sans intermédiaires ni contre-pouvoirs. Même dans le cas des grandes négociations nationales comme la réforme du Code du travail ou l’assurance chômage, on a bien vu que le périmètre laissé aux partenaires sociaux est très cadré. Manifestement, on est face à un pouvoir politique qui considère que les organisations syndicales doivent uniquement intervenir au niveau de l’entreprise. Encore faut-il leur en donner les moyens, ce qui ne semble pas forcément le cas avec les CSE. Il y a là un paradoxe.
Comment jugez-vous la mise en place de ces comités sociaux économiques en entreprise, qui remplacent les anciennes instances (délégués du personnel, CHSCT et comité d’entreprise) ?
La réduction sensible du nombre d’élus et des moyens alloués n’est pas sans poser question. Idem concernant l’augmentation du périmètre géographique qui va compliquer l’intervention des représentants du personnel sur le terrain au contact des salariés. C’est un peu la quadrature du cercle. On va tendre vers un syndicalisme d’expertise avec des dossiers toujours plus complexes mobilisant de nombreuses compétences chez les élus.
Quelle lecture faite-vous du paysage syndical ?
On constate un effritement de la participation aux élections professionnelles, y compris dans la fonction publique. Au niveau de la représentativité, la CFDT est devenue la première organisation syndicale, davantage en raison de l’érosion régulière de la CGT que par une réelle progression de son nombre de voix. Sans être une lame de fond, c’est un changement symbolique. L’autre élément frappant du dernier cycle électoral (ndlr : entre 2013 et 2016), c’est la montée en puissance du syndicalisme catégoriel, incarné par la CFE-CGC pour les populations de l’encadrement, ou autonome avec l’Unsa (ndlr : non représentative au niveau national interprofessionnel). Concernant la CFE-CGC, il y a un lien clair, outre son positionnement et son action syndicale, avec la tertiarisation et l’évolution sociologique du salariat.