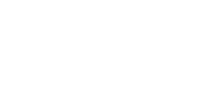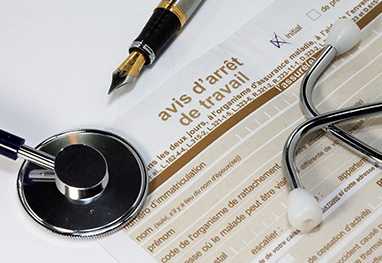
Le 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré deux revirements jurisprudentiels majeurs relatifs aux congés payés, alignant le droit français sur les exigences du droit de l’Union européenne (UE). Ces deux décisions, très attendues, permettent aux salariés un report des congés payés en cas de maladie, et obligent les employeurs à prendre en compte les congés payés dans le calcul des heures supplémentaires pour les salariés soumis au décompte hebdomadaire de la durée de travail.
REPORT DES CONGÉS EN CAS DE MALADIE PENDANT LES VACANCES
Jusqu’alors, lorsqu’un salarié tombait malade pendant ses congés, il ne pouvait prétendre au report des jours non pris. Selon la jurisprudence, c’était le motif initial de suspension du contrat de travail qui s’imposait et si le salarié tombait malade postérieurement au début de ses congés, ceux-ci étaient quand même consommés.
L’arrêt du 10 septembre 2025 opère un net revirement : le salarié qui justifie d’un arrêt de travail survenu pendant ses congés bénéficie du report des jours correspondants, sous réserve d’en avoir informé son employeur. Ce revirement résulte des exigences du droit européen, en particulier de l’article 7 de la directive 2003/88/CE, qui garantit un droit effectif à 4 semaines de congés payés annuels. La Cour de justice de l’UE (CJUE) avait déjà affirmé que le congé maladie et le congé payé ont des finalités distinctes - rétablissement d’un côté, repos et loisirs de l’autre - et ne peuvent donc se confondre.
Plus récemment, en 2023, la CJUE a confirmé que les congés payés non pris pour cause de maladie doivent pouvoir être reportés, tout en permettant aux États membres d’en limiter la durée (15 mois maximum). La Cour de cassation s’est alignée sur cette interprétation. La France avait en outre été mise en demeure par la Commission européenne en juin dernier à ce sujet.
Cette décision clarifie également que la période de report de 15 mois prévue par l’article L. 3141 19 1 du Code du travail s’applique aussi aux cas dans lesquels la maladie survient pendant les congés déjà posés.
INTÉGRATION DES CONGÉS DANS LE CALCUL DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Dans une autre décision rendue le même jour, la Cour de cassation bouleverse sa position sur le décompte des heures supplémentaires. Elle juge désormais que, pour les salariés soumis à un décompte hebdomadaire du temps de travail, les jours de congés payés doivent être assimilés à du temps de travail effectif pour apprécier si le seuil hebdomadaire déclenchant les heures supplémentaires est franchi.
Jusqu’alors, sauf convention collective plus favorable, les jours de congés étaient exclus du calcul : seule la durée de travail « effectivement accomplie » comptait. Un salarié qui travaillait par exemple 3 jours dans la semaine et posait 2 jours de congé n’atteignait pas le seuil de 35 heures, même s’il travaillait à temps plein sur les jours restants.
La Cour justifie son revirement par la nécessité d'assurer l’effectivité du droit au congé et d’éviter que les salariés soient pénalisés dans l’accès aux heures majorées en raison de l’exercice d’un droit garanti. Cette exclusion constituait une incitation indirecte à ne pas poser de congés, contrevenant aux principes de la jurisprudence européenne.
Cette solution est, à ce stade, cantonnée au décompte hebdomadaire. Les autres modalités (annualisation, forfaits mensuels) ne sont pas directement concernées par cette décision.
UN DOUBLE ALIGNEMENT SUR LE DROIT EUROPÉEN
Ces deux arrêts traduisent la volonté de la Cour de cassation d’assurer la conformité du droit français aux exigences du droit de l’UE en matière de congés payés. Pour les employeurs, ces revirements appellent une révision rapide des pratiques RH, notamment des logiciels de paie et des systèmes de gestion du temps. Pour les salariés, ils renforcent la protection d’un droit fondamental souvent fragilisé par des pratiques de terrain.
Johaquim Assedo