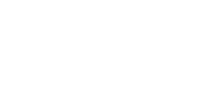Retour aux actualités précédentes
Les cadres réclament plus de transparence salariale
S’ils bénéficient d’une hausse de +1,8 % de la rémunération médiane, 64 % des cadres attendent plus de transparence salariale de la part des entreprises, selon le baromètre annuel de l’Apec.

L’Association pour l’emploi des cadres (Apec) organisait le 18 novembre la présentation de son baromètre annuel sur l’évolution des rémunérations des cadres. Une conférence dont le timing n’est pas anodin. « Nous sommes en pleine période des NAO et de ralentissement de l’inflation », explique Laetitia Niaudeau, directrice générale adjointe de l’Apec. « Dans ce contexte, nous pensons que les chiffres à venir seront particulièrement instructifs. »
Des augmentations, mais pas pour tout le monde
Selon le baromètre annuel de l’Apec, alors que l’inflation tombe à 1 % seulement en 2025 (contre 2 % en 2024 et 4,9 % en 2023), la rémunération médiane (fixe + variable) des cadres atteint 55 000 euros, soit + 1,8 % par rapport à 2024. La rémunération moyenne grimpe à 64 000 avec un 1er décile à 38 000 et un 9e décile à 95 000. La médiane fixe, elle, est de 52 000 euros.
Une tendance encourageante, donc, mais qui ne masque pas certaines réalités contrastées. Notamment le fait que près de la moitié des cadres n’a reçu aucune augmentation cette année : « la part des cadres ayant déclaré bénéficier d’une augmentation en 2025 a baissé à 53 %, dont 51 % des femmes », précise Hélène Garner, directrice des Données et Études de l'Apec. Un recul de 7 points par rapport à 2024 (60 %), et inférieur aux chiffres de 2023 (59 %) et de 2022 (57 %).
Les moins de 30 ans et les hommes, premiers bénéficiaires
Les écarts de genre persistent également sur le fait de bénéficier d’une part variable, qui concerne 54 % des hommes cadres, mais seulement 45 % des femmes.
De plus, « depuis 2019, les inégalités salariales entre les femmes et hommes à poste et profil identique n’ont quasiment pas reculé. Après une hausse de 0,6 % en 2020, elles ne baissent de 0,1 % par an en moyenne. Elles sont de 6,8 % aujourd’hui », expose-t-elle. Un aspect rassurant, toutefois, est que cet écart n’est que de 2 points chez les nouvelles générations (moins de 35 ans), contre 12 % chez les 55 ans et plus.
Au niveau des tranches d’âges, 66 % des cadres de moins de 30 ans, 59 % des 30 à 39 ans, 51 % des 40 à 49 ans et 42 % des plus de 50 ans ont reçu une augmentation. Des chiffres en baisse par rapport à 2024, mais plus élevés qu’en 2023. Si les jeunes sont les premiers bénéficiaires de ces augmentations, leur rémunération médiane reste la plus basse, à 43 000 euros annuels, contre 52 000, 60 000 et 62 000 pour les autres tranches d’âges.
Transparence salariale, un tabou français ?
Mais, dans ce contexte de maintien des inégalités, quelle est la perception des entreprises et des cadres (notamment manageurs) sur la transparence salariale ? À quelques mois de la directive européenne renforçant les obligations des entreprises en la matière, prévue pour le 7 juin 2026, l’APEC a également présenté les résultats d’une étude comparative européenne (France, Allemagne, Italie et Espagne) sur ce sujet.
Premier enseignement de l’étude, le fait que 64 % des cadres français -dans la moyenne des autres pays européens- estiment que les salaires de chacun devraient être connus de tous dans l’entreprise. Cette proportion monte à 71 % chez les moins de 35 ans, mais retombe à 59 % chez les plus de 55 ans.
D’ailleurs, comparé aux autres pays européens, les cadres français sont plus nombreux (46 %) à juger leur entreprise comme « opaque » en matière de salaires, contre 38 % des Allemands, 33 % des espagnols et 28 % des italiens. De plus, 81 % considèrent qu’il est difficile de savoir qui a été augmenté, 74 % de connaître les salaires réels par poste et 66 % d’accéder à une grille de salaire.
L’opacité est telle qu’un français sur deux a du mal à se situer leur salaire par rapport à ceux d’un poste similaire dans d’autres entreprises… mais aussi à leurs propres collègues en interne.
Les entreprises à la traîne
Un long chemin reste donc à parcourir pour que les entreprises respectent les prérogatives de la loi sur la transparence salariale. Elle exigera notamment d'afficher les salaires sur les offres d'emploi, de communiquer clairement les critères de rémunération aux employés, et pour les entreprises de plus de 100 salariés, de corriger les écarts salariaux supérieurs à 5 % à poste égal. Aujourd’hui, seules 12 % des entreprises disent avoir déjà pris des mesures pour se conformer à la future directive, et 14 % ont commencé à en discuter. Les grands groupes sont plus actifs (38 % au total) que les PME (26 %).
Malgré ces réticences, les entreprises font preuve d’un certain paradoxe : 74 % des manageurs demandent systématiquement ou souvent aux candidats leur salaire actuel/précédent, mais seulement 46 % indiquent des informations salariales dans leurs offres d'emploi !
Toujours selon l’étude relatée par l’Apec, les entreprises identifient quatre obstacles majeurs : l'investissement nécessaire pour la mise en conformité, la difficulté à justifier objectivement les écarts actuels (63 % des manageurs), la crainte de conflits à la suite des révélations (62 %), et la peur que l'affichage des salaires décourage certains candidats (38 %), ou attirer des candidats uniquement intéressés par le salaire.
Pourtant, dans un contexte où les questions de disparité salariale préoccupent de plus en plus les français, intégrer cette directive sera particulièrement bénéfique pour les entreprises, affirme Gilles Gateau, Directeur général de l'Apec : « elle améliorera l’efficacité des processus de recrutement, la motivation à la performance, et permettra, si elle est respectée, de renforcer la confiance entre les salariés et les employeurs ». Combien de temps auront les entreprises pour se mettre en conformité face à la loi ? « C’est encore une inconnue », reconnait-il, « mais cela fera sans doute partie des éléments de la transposition. »
Propos recueillis par François Tassain