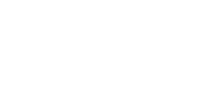Tribune – Secrétaire nationale CFE-CGC à la transition vers un monde durable, Madeleine Gilbert en appelle à un dialogue social structuré et inclusif, condition indispensable pour réussir une transition juste et soutenable dans les entreprises.

La transition écologique est encore trop souvent perçue comme une contrainte technique ou financière, rarement comme un enjeu social partagé. Pourtant, elle transforme en profondeur le monde du travail : métiers, compétences, conditions de travail, santé, organisation… autant de dimensions qui ne peuvent être repensées sans les travailleurs eux-mêmes. Un dialogue social structuré et inclusif est une condition indispensable pour réussir une transition juste, durable et soutenable.
Le lancement du troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3) en mars dernier constitue un tournant. Préparant la France à un réchauffement de +4 °C à l’horizon 2100, ce plan prévoit des mesures d’adaptation pour tous les secteurs. Mais sans implication des salariés et de leurs représentants, ces transformations resteront inopérantes. La mesure 11 du PNACC-3, qui appelle à adapter les conditions de travail aux nouveaux risques climatiques, souligne l’urgence d’un dialogue renforcé sur la prévention, la santé, et l’évolution des métiers.
La transition écologique affecte tous les secteurs : gestion des ressources, économie circulaire, biodiversité, mobilité, gestion des déchets… Elle bouleverse les modèles productifs (énergie, logistique, industrie) et impose de nouvelles compétences, une reconfiguration des métiers et une anticipation des besoins. Selon les projections, la planification écologique pourrait créer 150 000 emplois nets d’ici 2030, tout en transformant profondément environ 8 millions d’emplois. Quant à la biodiversité, près de 80 % des emplois en France dépendent directement ou indirectement des écosystèmes (rapport Delannoy, 2016).
Ces mutations appellent une gouvernance partagée : sans stratégie d’anticipation sociale, les déséquilibres territoriaux et les fractures sociales risquent de s’aggraver. À l’inverse, un dialogue social actif peut transformer ces défis en opportunités d’innovation, de revalorisation du travail et de cohésion.
Plusieurs textes fondateurs ont ouvert la voie à une meilleure intégration des enjeux environnementaux dans le dialogue social :
- La loi Pacte (2019) a élargi la responsabilité des entreprises à la prise en compte de leurs impacts environnementaux.
- La loi Climat et Résilience (2021) a donné un rôle explicite aux comités sociaux et économiques (CSE) dans l’analyse des conséquences environnementales des décisions de l’entreprise (articles 40 et 41 du Code du travail).
Désormais, les trois grandes consultations du CSE (stratégie, emploi, conditions de travail) doivent intégrer une dimension environnementale. La Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) devient un outil structurant qui permet d’objectiver les données et d’éclairer les échanges. Pourtant, dans les faits, ces nouvelles prérogatives restent largement sous-utilisées. Faute de formation, de moyens dédiés ou de volonté partagée, la mission environnementale des instances représentatives du personnel (IRP) demeure marginale, quand elle devrait être centrale. Le Document unique d’évaluation des risques (DUERP), bien qu’encore centré sur les risques professionnels, n’intègre pas encore explicitement les effets des dérèglements climatiques sur la santé des salariés, et traite de ces risques comme des problématiques distinctes.
Il est temps de passer des intentions aux actes. Voici onze propositions concrètes pour structurer un dialogue social capable d’accompagner la transition écologique :
- Créer des commissions développement durable dans les CSE par accord d’entreprise (article L.2315-45 du Code du travail).
- Former les représentants du personnel aux enjeux environnementaux, à la directive CSRD, à la CS3D, et aux outils de reporting extra-financier.
- Attribuer des heures de délégation supplémentaires dédiées à l’expertise environnementale.
- Rendre la BDESE réellement opérationnelle, avec des indicateurs intégrés sur les volets sociaux, économiques et environnementaux.
- Expérimenter des accords d’entreprise « transition écologique », articulant organisation du travail, mobilités, santé, ressources, compétences.
- Créer une base centralisée d’accords types (climat, biodiversité, conditions de travail), sur le modèle de Légifrance.
- Inclure des critères environnementaux dans les négociations d’intéressement et de rémunérations variables.
- Aligner la rémunération des dirigeants sur des objectifs environnementaux.
- Associer les IRP à la co-construction des stratégies climat, en amont des décisions.
- Faire du dialogue social un outil d’anticipation et de justice sociale, et non de simple gestion des crises.
- Intégrer systématiquement les enjeux de transition écologique dans les démarches de GEPP (Gestion des emplois et des parcours professionnels) afin d’anticiper les mutations des emplois et d’accompagner les salariés dans l’évolution de leurs compétences.
Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) appelait déjà, en 2020, à intégrer le climat dans les négociations sociales. La plateforme RSE de France Stratégie a, dès 2019, recommandé de faire de la RSE un objet du dialogue social. Ces appels prennent aujourd’hui une résonance stratégique.
Les salariés sont prêts. Ils souhaitent être informés, impliqués, acteurs des transformations. Les représentants du personnel sont de plus en plus demandeurs d’une implication active sur les enjeux environnementaux, et souhaitent être pleinement associés à la définition et au suivi des stratégies de transition des entreprises.
Il ne s’agit plus seulement de « verdir » les instances, mais d’aligner les dimensions sociale, économique et environnementale dans la gouvernance des entreprises. Ce triptyque est le seul qui puisse garantir une transition juste, pérenne, et collectivement acceptée.
Madeleine Gilbert, secrétaire nationale CFE-CGC à la transition vers un monde durable